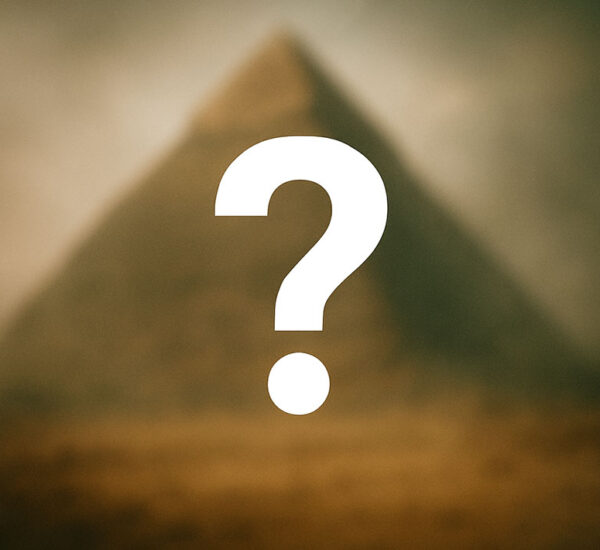| Emplacement : | Saqqarah Sud, au sein du complexe funéraire de Pépi II |
| Date estimée de construction : | vers 2200 av. J.-C. |
| Pharaon associé : | Pépi II |
| Personne à qui elle est destinée : | Reine Ouedjebten, épouse royale de Pépi II |
| Type de pyramide : | à faces lisses |
| Hauteur : | environ 20 m (38 à 40 coudées royales) |
| Base : | environ 25 m (47 coudées royales) |
| Particularité : | Contient des Textes des Pyramides gravés ; temple funéraire richement décoré de bas-reliefs |
| État actuel : | Très ruinée, mais le plan interne et certaines inscriptions sont encore visibles |
Ouedjebten : la dernière épouse d’un roi millénaire
La reine Ouedjebten, épouse du roi Pépi II, vécut dans les dernières décennies de l’Ancien Empire, à une époque où le pouvoir royal vacillait lentement sous le poids des siècles.
Son nom, parfois traduit par « Celle qui parle avec droiture » ou « Celle qui apporte la pureté », évoque une dimension morale et spirituelle typique des reines de la fin de la VIᵉ dynastie.
Si les sources la concernant sont rares, tout indique qu’Ouedjebten fut l’une des dernières grandes figures féminines à incarner la royauté divine avant l’effondrement du système pharaonique.
Elle partagea sans doute les dernières années du règne de Pépi II, un souverain très âgé, et participa au maintien des rites et des traditions dans un empire qui s’éteignait doucement.
Le complexe funéraire de Saqqarah Sud : le cœur sacré des reines
La pyramide d’Ouedjebten s’élève dans le complexe royal de Pépi II, à Saqqarah Sud, au sud de Memphis.
Ce site formait une véritable nécropole dynastique, où reposaient non seulement le roi, mais aussi plusieurs de ses épouses et reines-mères : Neith, Ipout II, et Ouedjebten.
Chaque reine possédait son propre complexe, organisé autour d’une pyramide, d’un temple funéraire, et d’une enceinte de pierre. Ces sanctuaires étaient disposés autour de celui du roi, comme les astres autour du soleil, formant un système cosmique miniature.
Ce dispositif n’était pas qu’un choix architectural : il exprimait une théologie raffinée, où les reines représentaient les forces protectrices et nourricières du pharaon divin.
Ouedjebten y occupe une place particulière : sa pyramide est la plus méridionale, comme si elle marquait la frontière symbolique entre la lumière de l’empire et l’ombre du déclin.
L’architecture : élégance et continuité
La pyramide d’Ouedjebten, bien que modeste comparée à celle du roi, obéit aux mêmes principes de conception. Haute d’environ 20 mètres et large de 25 mètres, elle était bâtie en calcaire local et revêtue d’un parement de calcaire de Tourah, aujourd’hui disparu.
Son entrée au nord ouvre sur un couloir descendant, menant à une antichambre et à une chambre funéraire. Le plafond, orné d’un ciel étoilé, évoque la voûte céleste où la reine devait renaître en étoile impérissable.
Les Textes des Pyramides gravés sur les parois témoignent d’une spiritualité subtile : ils ne célèbrent pas la conquête du ciel, mais la fusion de l’âme féminine avec la lumière divine.
Ces inscriptions sont rédigées dans un style proche de ceux des rois, mais adaptées à la théologie du féminin sacré, exaltant la protection, la pureté et la renaissance.
La chambre sépulcrale, construite en calcaire fin, abritait un sarcophage aujourd’hui disparu, mais dont les fragments montrent un travail de taille minutieux.
Le temple funéraire : le culte du féminin éternel
Accolé à la face est de la pyramide, le temple funéraire d’Ouedjebten suivait le modèle classique des temples de reines de la VIᵉ dynastie.
Il comportait une cour à ciel ouvert, un autel d’offrandes, et plusieurs salles de culte décorées de bas-reliefs.

Des fragments de ces reliefs, découverts lors des fouilles, montrent la reine assise devant des tables couvertes d’offrandes, entourée de porteurs de nourriture, de fleurs et de tissus sacrés.
Ces scènes, empreintes de douceur et de dignité, traduisent la croyance selon laquelle la reine, dans l’au-delà, devenait la mère régénératrice du roi et la garante du cycle de la vie.
Des jarres d’offrandes, des vases en albâtre et des outils de culte retrouvés sur place attestent de l’existence d’un culte posthume actif, probablement entretenu par des prêtres dédiés.
Les fouilles et découvertes : un souvenir sauvé du sable
La pyramide d’Ouedjebten fut explorée au début du XXᵉ siècle par Gustave Jéquier, égyptologue suisse, qui mit au jour les ruines du temple et les chambres internes.
Sous les débris, il découvrit les Textes des Pyramides encore gravés sur les murs, confirmant que la reine bénéficiait d’un traitement royal dans sa mort.
Les reliefs et les fragments architecturaux retrouvés sur place permirent de reconstituer partiellement le plan du complexe.
Jéquier nota la qualité remarquable de la gravure des hiéroglyphes, d’une finesse égale à celle des monuments royaux, preuve que, malgré la crise politique, les artisans conservaient un haut niveau de maîtrise.
Les objets découverts — vases d’offrandes, outils rituels, fragments de statues — sont aujourd’hui conservés dans les musées du Caire et de Berlin.
Héritage spirituel : la reine et la lumière qui s’éteint
La pyramide de la reine Ouedjebten marque la fin d’une tradition millénaire : celle des grandes reines associées à la royauté solaire.
Après elle, plus aucune reine ne possédera de pyramide complète, car le monde de l’Ancien Empire s’effondre.
Mais à travers ce monument discret, la mémoire d’Ouedjebten demeure comme celle d’une femme solaire, dépositaire du pouvoir divin, gardienne de la résurrection du roi et du cosmos.
Son nom se joint à ceux de Neith et d’Ipout II comme les dernières étoiles d’une constellation qui s’éteint lentement dans le ciel de Saqqarah.
Et quand le vent du désert balaie les ruines, on dirait encore que la voix d’une reine murmure dans le silence des pierres :
« Je suis celle qui veille sur le Soleil endormi. »
Pour tout savoir sur les pyramides égyptiennes, vous pouvez consulter la page principale en cliquant ici.
Institutions et revues francophones
Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)
- Site officiel :
https://www.ifao.egnet.net/ ifao.egnet.net+1 - Catalogue des publications (monographies, MIFAO, BIFAO, etc.) :
https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/ ifao.egnet.net
Bulletin de l’IFAO (BIFAO)
- Présentation de la revue sur OpenEdition (accès à certains articles) :
https://journals.openedition.org/bifao/ OpenEdition Journals - Collection BIFAO sur Persée :
https://www.persee.fr/collection/bifao Persée
Département des Antiquités égyptiennes du Louvre
- Page officielle du département :
https://www.louvre.fr/recherche-et-conservation/departement-des-antiquites-egyptiennes Le Louvre - Ressources pédagogiques « Antiquités égyptiennes » :
https://www.louvre.fr/se-former-et-transmettre/trouver-des-ressources/antiquites-egyptiennes Le Louvre
Revue Égypte, Afrique & Orient
- Site officiel de la revue :
https://www.revue-egypte.org/ Revue Égypte Afrique & Orient - Présentation de la revue (fiche descriptive) :
https://ancienegypte.fr/albums_livres/afrique_orient.htm ancienegypte.fr
Association d’égyptologie Kemet (ressource francophone sérieuse)
- Site de l’Association périgourdine d’égyptologie KEMET :
https://kemet24.jimdofree.com/ Site de kemet24 !
Ouvrages de référence (pages éditeurs / libraires)
Nicolas Grimal – Histoire de l’Égypte ancienne (Fayard)
- Fiche livre chez Fayard :
https://www.fayard.fr/livre/histoire-de-legypte-ancienne-9782213021911/ Fayard+1
Pierre Tallet & Mark Lehner – Les papyrus de la mer Rouge
(= volume grand public sur Merer et la construction de la pyramide de Khéops)
- Fiche chez Actes Sud :
https://actes-sud.fr/catalogue/histoire/les-papyrus-de-la-mer-rouge Actes Sud - Fiche chez Place des Libraires (détail + résumé) :
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782877729758-les-papyrus-de-la-mer-rouge-et-la-construction-des-pyramides-mark-lehner-pierre-tallet/ Place des Libraires
Article scientifique sur les papyrus de Wadi el-Jarf (Merer)
- Article de Pierre Tallet, « Les papyrus de la mer Rouge (ouadi el-Jarf, golfe de Suez) », CRAI 2013 :
https://www.academia.edu/9644107/_Les_papyrus_de_la_mer_Rouge_ouadi_el_Jarf_golfe_de_Suez_CRAI_2013_p_1015_1024 Academia
Michel Valloggia – Au cœur d’une pyramide. Une mission archéologique en Égypte
- Fiche éditeur Infolio :
https://www.infolio.ch/livre/au-coeur-dune-pyramide-une-mission-archeologique-en-egypte/ Infolio
I.E.S. Edwards – Les pyramides d’Égypte (trad. française)
- Fiche de l’édition française (notice détaillée) :
https://www.chasse-aux-livres.fr/prix/2253058637/les-pyramides-d-egypte-i-e-s-edwards Chasse aux Livres