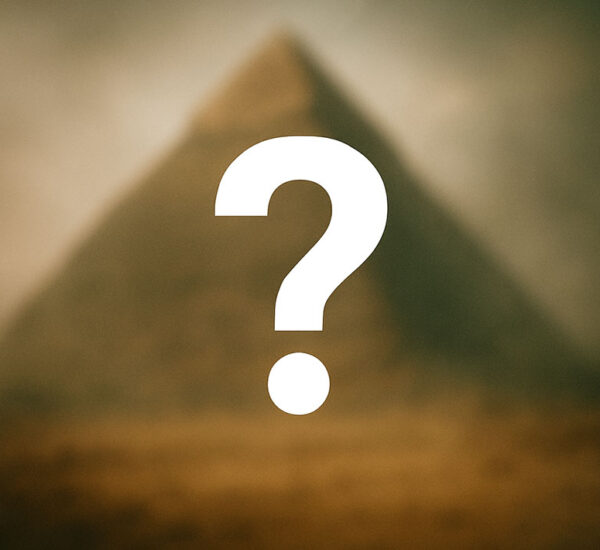| Emplacement : | Saqqarah Sud, dans le complexe funéraire de Pépi Ier |
| Date estimée de construction : | vers 2330 av. J.-C. |
| Pharaon associé : | Pépi Ier Meryré |
| Personne à qui elle est destinée : | Reine Inenek-Inti |
| Type de pyramide : | à faces lisses |
| Hauteur : | environ 21 m (40 coudées royales) |
| Base : | environ 24 m (46 coudées royales) |
| Particularité : | Temple funéraire exceptionnellement bien préservé et doté d’un mur d’enceinte indépendant |
| État actuel : | Partiellement ruinée, mais la structure du temple et plusieurs éléments décoratifs sont encore visibles |
Inenek-Inti : la reine dont le nom traverse les millénaires
Parmi les épouses de Pépi Ier, la reine Inenek-Inti se distingue par la qualité de sa tombe et par le soin méticuleux accordé à son complexe funéraire. Son nom, parfois transcrit Inenek-Enti ou Inenek-Inti, évoque une personnalité noble et influente à la cour de la VIᵉ dynastie.
Elle fut sans doute l’une des épouses les plus respectées du roi, bénéficiant d’un culte funéraire autonome — privilège rare pour une reine de cette époque. Sa pyramide, construite à Saqqarah Sud, se dresse à proximité immédiate de celle de Pépi Ier, comme un reflet plus discret du monument royal.

Son nom royal était suivi du titre de Grande de la louange, Celle qui voit Horus et Seth, Amie d’Horus, des appellations qui soulignent sa participation symbolique à l’équilibre cosmique entre les forces solaires et célestes. Inenek-Inti n’était pas seulement une épouse royale : elle incarnait, au cœur du temple, la médiatrice entre le monde des dieux et celui des hommes.
Le complexe funéraire d’Inenek-Inti : un microcosme royal au féminin
Situé à l’ouest de la pyramide principale de Pépi Ier, le complexe d’Inenek-Inti suivait la même logique que celui du roi, bien que de taille réduite. Il comprenait une pyramide à faces lisses, un temple funéraire complet, une cour à colonnes, un autel d’offrandes, et un mur d’enceinte indépendant — particularité rare parmi les reines contemporaines.
Cette autonomie architecturale souligne le statut privilégié d’Inenek-Inti au sein du harem royal. Là où d’autres épouses partageaient des structures communes, elle possédait un espace sacré entièrement à son nom, symbole d’une autorité spirituelle et d’un culte posthume bien établi.
Les reliefs retrouvés dans les ruines de son temple montrent des scènes d’offrandes, de processions et de prêtres accomplissant des rites en son honneur. L’ensemble reflète la finesse du savoir-faire artistique de la VIᵉ dynastie, où chaque motif, chaque hiéroglyphe devient invocation.
Une architecture raffinée : la géométrie de l’éternité
La pyramide d’Inenek-Inti atteignait environ 21 mètres de hauteur pour une base de 24 mètres. Construite en blocs de calcaire local et recouverte d’un parement de calcaire de Tourah, elle s’inscrivait dans la tradition des pyramides royales à faces lisses.
L’entrée se trouvait au nord, comme le veut la symbolique funéraire égyptienne : elle ouvrait la voie vers le royaume des étoiles impérissables, domaine du nord céleste où les rois et les reines devenaient immortels.
Le couloir descendant menait à une antichambre, puis à la chambre funéraire, qui abritait jadis un sarcophage en calcaire poli. Même si la décoration intérieure a disparu, les traces laissées dans la pierre témoignent d’un raffinement certain.

Chaque détail architectural — orientation, proportion, emplacement — répond à une symbolique cosmique. Le carré de la base représente la Terre, tandis que la pointe de la pyramide vise le ciel, figurant l’ascension de la reine vers les sphères divines.
Un temple funéraire d’une richesse exceptionnelle
C’est dans son temple funéraire qu’Inenek-Inti affirme toute sa singularité. Contrairement à d’autres reines, dont les temples furent réduits à de simples chapelles, celui d’Inenek possédait plusieurs salles : une antichambre, une cour à piliers, une salle d’offrandes et un sanctuaire.
Des fragments de bas-reliefs retrouvés sur place montrent des scènes d’offrandes, de parfums, de fleurs et de nourriture déposés pour la reine. Ces représentations ne sont pas de simples décorations : elles sont magiques, destinées à assurer la continuité de son existence dans l’au-delà.
Le mur d’enceinte, autonome et soigneusement bâti, montre que le culte d’Inenek-Inti perdura bien après sa mort. On a retrouvé des traces de prêtres et d’officiants attachés spécifiquement à sa mémoire.
Redécouverte archéologique : le travail de Gustave Jéquier
La pyramide d’Inenek-Inti fut mise au jour dans les années 1920 par l’égyptologue Gustave Jéquier, dont les fouilles à Saqqarah ont profondément renouvelé la compréhension de la VIᵉ dynastie.
Sous les décombres, il découvrit les fondations du temple, des fragments de reliefs peints et des blocs inscrits au nom de la reine. Grâce à ces éléments, il put reconstituer l’organisation du complexe et confirmer le statut exceptionnel d’Inenek-Inti au sein du harem royal.
Les objets retrouvés — vases d’offrandes, restes d’albâtre, fragments de statues — attestent d’un culte funéraire durable, probablement entretenu par une lignée de prêtres jusqu’à la Première Période intermédiaire.
Héritage et signification spirituelle de la pyramide d’Inenek-Inti
Aujourd’hui, il ne subsiste de la pyramide que des vestiges de murs et de blocs épars, rongés par le temps et le sable. Pourtant, le souvenir d’Inenek-Inti perdure comme celui d’une reine dont la mémoire résista à l’oubli.
Sa pyramide témoigne d’une ère où les épouses royales commencèrent à acquérir une dimension spirituelle indépendante, reflet d’une évolution profonde dans la conception de la royauté.
Inenek-Inti n’était plus seulement la compagne du pharaon : elle était, à sa manière, une représentante du principe féminin divin, gardienne de l’équilibre cosmique, miroir terrestre de la déesse Isis.
Ainsi, à travers les ruines de Saqqarah, la voix d’Inenek-Inti résonne encore : une voix de femme, de lumière et de pierre, inscrite à jamais dans la géométrie sacrée du désert.
Pour tout savoir sur les pyramides égyptiennes, vous pouvez consulter la page principale en cliquant ici.
Institutions et revues francophones
Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)
- Site officiel :
https://www.ifao.egnet.net/ ifao.egnet.net+1 - Catalogue des publications (monographies, MIFAO, BIFAO, etc.) :
https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/ ifao.egnet.net
Bulletin de l’IFAO (BIFAO)
- Présentation de la revue sur OpenEdition (accès à certains articles) :
https://journals.openedition.org/bifao/ OpenEdition Journals - Collection BIFAO sur Persée :
https://www.persee.fr/collection/bifao Persée
Département des Antiquités égyptiennes du Louvre
- Page officielle du département :
https://www.louvre.fr/recherche-et-conservation/departement-des-antiquites-egyptiennes Le Louvre - Ressources pédagogiques « Antiquités égyptiennes » :
https://www.louvre.fr/se-former-et-transmettre/trouver-des-ressources/antiquites-egyptiennes Le Louvre
Revue Égypte, Afrique & Orient
- Site officiel de la revue :
https://www.revue-egypte.org/ Revue Égypte Afrique & Orient - Présentation de la revue (fiche descriptive) :
https://ancienegypte.fr/albums_livres/afrique_orient.htm ancienegypte.fr
Association d’égyptologie Kemet (ressource francophone sérieuse)
- Site de l’Association périgourdine d’égyptologie KEMET :
https://kemet24.jimdofree.com/ Site de kemet24 !
Ouvrages de référence (pages éditeurs / libraires)
Nicolas Grimal – Histoire de l’Égypte ancienne (Fayard)
- Fiche livre chez Fayard :
https://www.fayard.fr/livre/histoire-de-legypte-ancienne-9782213021911/ Fayard+1
Pierre Tallet & Mark Lehner – Les papyrus de la mer Rouge
(= volume grand public sur Merer et la construction de la pyramide de Khéops)
- Fiche chez Actes Sud :
https://actes-sud.fr/catalogue/histoire/les-papyrus-de-la-mer-rouge Actes Sud - Fiche chez Place des Libraires (détail + résumé) :
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782877729758-les-papyrus-de-la-mer-rouge-et-la-construction-des-pyramides-mark-lehner-pierre-tallet/ Place des Libraires
Article scientifique sur les papyrus de Wadi el-Jarf (Merer)
- Article de Pierre Tallet, « Les papyrus de la mer Rouge (ouadi el-Jarf, golfe de Suez) », CRAI 2013 :
https://www.academia.edu/9644107/_Les_papyrus_de_la_mer_Rouge_ouadi_el_Jarf_golfe_de_Suez_CRAI_2013_p_1015_1024 Academia
Michel Valloggia – Au cœur d’une pyramide. Une mission archéologique en Égypte
- Fiche éditeur Infolio :
https://www.infolio.ch/livre/au-coeur-dune-pyramide-une-mission-archeologique-en-egypte/ Infolio
I.E.S. Edwards – Les pyramides d’Égypte (trad. française)
- Fiche de l’édition française (notice détaillée) :
https://www.chasse-aux-livres.fr/prix/2253058637/les-pyramides-d-egypte-i-e-s-edwards Chasse aux Livres