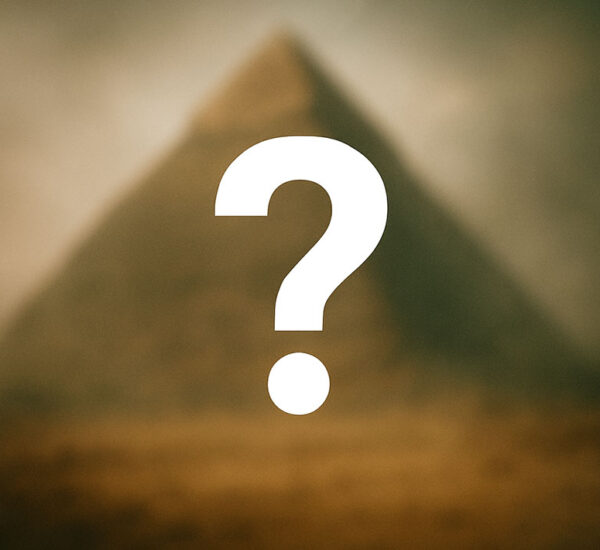| Emplacement : | Saqqarah, au sud-ouest de la pyramide de Djedkarê Isési |
| Date estimée de construction : | vers 2375–2345 av. J.-C. |
| Pharaon à qui elle est destinée : | Ounas, dernier roi de la Ve dynastie |
| Type de pyramide : | Pyramide à faces lisses |
| Hauteur : | ~43 m |
| Base : | ~57,5 m × 57,5 m |
| Particularité : | Première pyramide de toute l’histoire égyptienne à contenir les Textes des Pyramides gravés dans la pierre |
| État actuel : | Très ruinée extérieurement ; intérieur remarquablement conservé |
Ounas : le roi qui ouvrit les portes du verbe
Ounas, dernier souverain de la Ve dynastie, ne régna pas aussi longtemps que ses prédécesseurs et ne laissa pas de gigantesques monuments.
Mais son héritage est immense :
il fut le premier pharaon à faire graver dans les parois de sa chambre funéraire les Textes des Pyramides, un corpus sacré destiné à guider le roi dans sa renaissance.
Ounas n’a pas seulement construit une pyramide :
il a libéré la parole divine dans la pierre.
Saqqarah : un choix tourné vers l’héritage
Ounas délaisse Abousir, la nécropole traditionnelle des rois solaires, pour revenir à Saqqarah, près de la zone où s’élèveront les pyramides de la VIe dynastie.
Son emplacement marque une transition et un ancrage :
– un retour à la tradition ancienne,
– mais aussi un laboratoire pour la nouvelle idéologie funéraire qui va émerger.
Saqqarah devient le théâtre d’une révolution spirituelle.
Une pyramide modeste, mais au cœur d’une innovation
Avec seulement 43 mètres de hauteur, la pyramide d’Ounas est l’une des plus petites des rois de l’Ancien Empire.
Sa superstructure est aujourd’hui très ruinée, presque disparue, ressemblant davantage à une colline de gravats qu’à une pyramide.
Pourtant, son apparence modeste dissimule un trésor inestimable — un texte sacré qui allait traverser trois millénaires.

Un temple funéraire riche en scènes uniques
Le temple funéraire d’Ounas, bien qu’en ruine, a révélé des reliefs fascinants :
– scènes d’expédition au désert,
– processions d’offrandes,
– représentations d’artisans,
– scènes agricoles,
– et surtout, les célèbres scènes de famine, où des populations émaciées sont représentées avec un réalisme glaçant.
Ces reliefs, stylistiquement raffinés, font de son temple funéraire l’un des plus importants de l’Ancien Empire pour comprendre la vie quotidienne.

Les Textes des Pyramides : la voix des dieux gravée dans l’ombre
En pénétrant dans la substructure de la pyramide, la surprise est totale.
Là où les pyramides précédentes sont muettes, celle d’Ounas parle.
Les murs de la chambre funéraire et du couloir sont couverts d’inscriptions hiéroglyphiques d’un bleu profond, représentant :
– des formules d’ascension céleste,
– des invocations aux dieux,
– des rituels d’union avec Rê et Osiris,
– des instructions magiques pour franchir les obstacles du monde souterrain.

Ces textes ne sont pas décoratifs : ils sont opératoires.
Ils constituent la première version d’un corpus qui évoluera en Textes des Sarcophages et en Livre des Morts. Ounas devient ainsi le pionnier d’une nouvelle théologie royale.
Une chambre funéraire où le roi renaît
La chambre funéraire, construite en calcaire fin et abritant un sarcophage en grauwacke, est un espace sacré où le texte devient un outil de transformation.
Ce n’est plus la pyramide qui garantit l’éternité du roi,
mais les mots gravés dans ses parois.
Cette inversion — du monument à la parole — est l’une des plus grandes innovations spirituelles de l’Égypte ancienne.
Un roi modeste mais essentiel
Ounas n’a pas bénéficié du prestige monumental de Sahourê, de Niouserrê ou des géants de Gizeh.
Son règne fut calme, son autorité stable mais discrète.
Et pourtant, il marque le plus grand tournant de la pensée funéraire égyptienne.
Avec Ounas, la royauté ne repose plus seulement sur la pierre,
mais sur la connaissance,
la magie,
et la parole sacrée.
Héritage : la pyramide qui changea tout
La pyramide d’Ounas est un paradoxe :
un monument minuscule qui contient la plus grande révolution spirituelle de l’Ancien Empire.
Elle ouvre la voie aux pyramides textuelles de la VIe dynastie,
à l’essor des rituels funéraires écrits,
et à toute la tradition littéraire qui accompagnait les morts dans l’au-delà.
Sous les gravats de sa superstructure repose un miracle :
la première fois où les dieux prononcèrent leurs secrets dans un tombeau royal.
Ounas, dans sa pyramide presque effacée, a laissé une lumière bien plus durable que la pierre :
le pouvoir des mots éternels.
Pour tout savoir sur les pyramides égyptiennes, vous pouvez consulter la page principale en cliquant ici.
Institutions et revues francophones
Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO)
- Site officiel :
https://www.ifao.egnet.net/ ifao.egnet.net+1 - Catalogue des publications (monographies, MIFAO, BIFAO, etc.) :
https://www.ifao.egnet.net/publications/catalogue/ ifao.egnet.net
Bulletin de l’IFAO (BIFAO)
- Présentation de la revue sur OpenEdition (accès à certains articles) :
https://journals.openedition.org/bifao/ OpenEdition Journals - Collection BIFAO sur Persée :
https://www.persee.fr/collection/bifao Persée
Département des Antiquités égyptiennes du Louvre
- Page officielle du département :
https://www.louvre.fr/recherche-et-conservation/departement-des-antiquites-egyptiennes Le Louvre - Ressources pédagogiques « Antiquités égyptiennes » :
https://www.louvre.fr/se-former-et-transmettre/trouver-des-ressources/antiquites-egyptiennes Le Louvre
Revue Égypte, Afrique & Orient
- Site officiel de la revue :
https://www.revue-egypte.org/ Revue Égypte Afrique & Orient - Présentation de la revue (fiche descriptive) :
https://ancienegypte.fr/albums_livres/afrique_orient.htm ancienegypte.fr
Association d’égyptologie Kemet (ressource francophone sérieuse)
- Site de l’Association périgourdine d’égyptologie KEMET :
https://kemet24.jimdofree.com/ Site de kemet24 !
Ouvrages de référence (pages éditeurs / libraires)
Nicolas Grimal – Histoire de l’Égypte ancienne (Fayard)
- Fiche livre chez Fayard :
https://www.fayard.fr/livre/histoire-de-legypte-ancienne-9782213021911/ Fayard+1
Pierre Tallet & Mark Lehner – Les papyrus de la mer Rouge
(= volume grand public sur Merer et la construction de la pyramide de Khéops)
- Fiche chez Actes Sud :
https://actes-sud.fr/catalogue/histoire/les-papyrus-de-la-mer-rouge Actes Sud - Fiche chez Place des Libraires (détail + résumé) :
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782877729758-les-papyrus-de-la-mer-rouge-et-la-construction-des-pyramides-mark-lehner-pierre-tallet/ Place des Libraires
Article scientifique sur les papyrus de Wadi el-Jarf (Merer)
- Article de Pierre Tallet, « Les papyrus de la mer Rouge (ouadi el-Jarf, golfe de Suez) », CRAI 2013 :
https://www.academia.edu/9644107/_Les_papyrus_de_la_mer_Rouge_ouadi_el_Jarf_golfe_de_Suez_CRAI_2013_p_1015_1024 Academia
Michel Valloggia – Au cœur d’une pyramide. Une mission archéologique en Égypte
- Fiche éditeur Infolio :
https://www.infolio.ch/livre/au-coeur-dune-pyramide-une-mission-archeologique-en-egypte/ Infolio
I.E.S. Edwards – Les pyramides d’Égypte (trad. française)
- Fiche de l’édition française (notice détaillée) :
https://www.chasse-aux-livres.fr/prix/2253058637/les-pyramides-d-egypte-i-e-s-edwards Chasse aux Livres