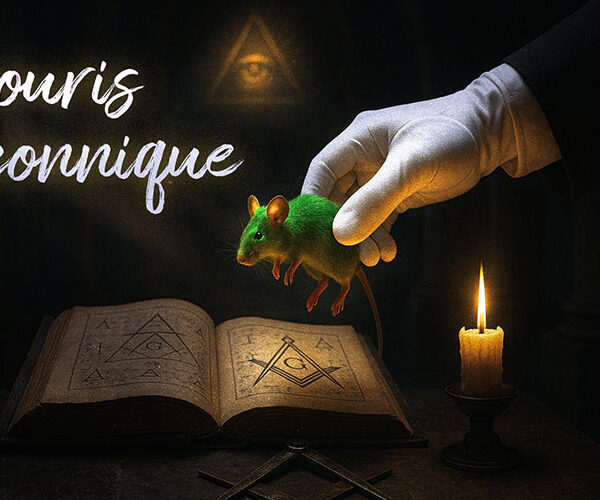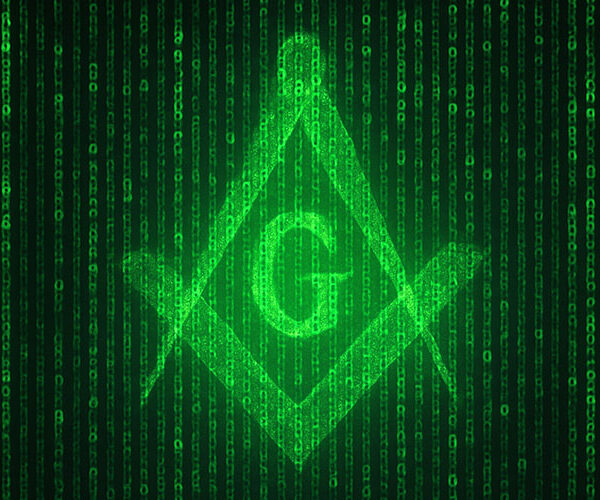Stargate : entre science-fiction, Égypte antique et théorie des anciens astronautes
Sorti en 1994 et réalisé par Roland Emmerich, Stargate est rapidement devenu un film culte de science-fiction. L’histoire débute en 1928 à Gizeh, où des archéologues découvrent une mystérieuse dalle et un immense anneau composé de matériaux inconnus. Des décennies plus tard, l’égyptologue Daniel Jackson est recruté pour déchiffrer les symboles et percer le secret de cet artefact.
L’anneau est en réalité une porte des étoiles, permettant de voyager instantanément vers d’autres planètes. L’expédition qui traverse ce portail se retrouve sur Abydos, où des humains vénèrent le dieu solaire Râ… qui s’avère être un extraterrestre. Derrière le spectacle et les effets spéciaux, le film s’appuie sur de véritables théories alternatives autour de l’histoire de l’Égypte.
La 4e dynastie et le mystère des pyramides
Le scénario de Stargate fait directement référence aux zones d’ombre de la IVe dynastie égyptienne (vers -2670 à -2450), celle qui a vu l’édification des plus grandes pyramides :
- Snéfrou et ses pyramides (rouge, rhomboïdale, Meïdoum)
- Khéops (la Grande Pyramide de Gizeh)
- Khephren
- Mykérinos
Malgré ces constructions titanesques, les sources historiques sont rares et parfois contradictoires. La fameuse « cartouche de Khéops » découverte dans les chambres de décharge de la grande pyramide en 1837 par le colonel Vyse a suscité de nombreux débats. Était-elle une preuve authentique ou une falsification destinée à flatter les collectionneurs européens ?
Ces incertitudes ouvrent la porte aux théories alternatives : et si les pharaons n’étaient pas réellement les bâtisseurs de ces monuments ?
L’évhémérisme : quand les dieux étaient des hommes
Derrière Stargate se cache un vieux courant philosophique : l’évhémérisme. Né au IIIe siècle av. J.-C. avec le penseur grec Évhémère, il affirme que les dieux étaient en réalité des hommes et des femmes divinisés après leur mort.
Cette idée traversa les siècles, reprise par les chrétiens pour discréditer les cultes païens, puis réinterprétée au XIXe siècle par Helena Blavatsky, fondatrice de la société théosophique. Elle y ajouta la notion de civilisations disparues (Hyperboréens, Atlantide, Mu), considérées comme des ancêtres dotés de pouvoirs quasi divins.
Du néo-évhémérisme aux anciens astronautes
Dans les années 1960, Louis Pauwels et Jacques Bergier popularisent ces idées dans Le Matin des magiciens, en y intégrant des influences extraterrestres et des sociétés secrètes. D’autres auteurs comme Robert Charroux, Jean Sendy, Erich von Däniken ou Zecharia Sitchin développeront ce qui deviendra la théorie des anciens astronautes.
Selon cette hypothèse, des extraterrestres auraient visité la Terre dans l’Antiquité, influençant nos civilisations, nos religions et nos constructions monumentales. Dans Stargate, ce sont précisément ces « dieux extraterrestres » que l’on retrouve : Râ et ses soldats, assimilés par les hommes aux divinités égyptiennes.
Stargate, reflet d’un imaginaire collectif
Stargate illustre parfaitement la manière dont la pop culture s’empare de théories marginales pour en faire des récits captivants. Le film combine archéologie mystérieuse, égyptologie contestée et science-fiction pour proposer une vision alternative : et si les dieux de l’Égypte antique n’avaient été que des voyageurs venus des étoiles ?
Entre divertissement et réflexion, Stargate rappelle que les symboles et les énigmes de l’histoire continuent de nourrir notre imaginaire.
🎬 Découvrez mon analyse complète en vidéo.